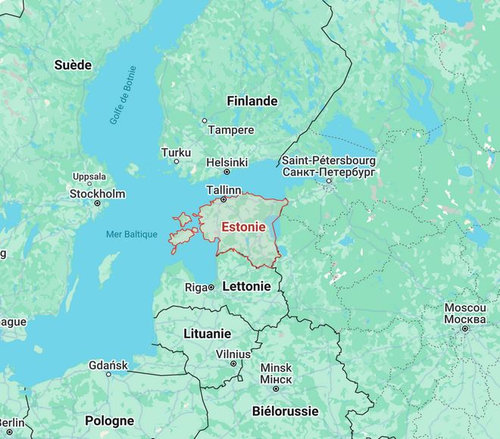Discussion du « Manifeste pour une démocratie du travail »
Damien, un ami membre des Ateliers Travail et Démocratie [1], a participé dans ce cadre à la rédaction collective d’un « Manifeste pour une démocratie du travail ». Il m’en avait envoyé le texte en même temps que je lui adressais mon « Manuel d’écologie du travail ».
Voici le lien vers la page du site où peut être téléchargé ce Manifeste (qui paraîtra en librairie le 17 avril 2026 aux éditions La Dispute).

Je me propose ici de le discuter, comme y invitent leurs rédacteurs. Je centrerai cette discussion sur leur décision épistémologique initiale et ses conséquences.
« Partir du travail »
L’objectif du Manifeste est de « montrer qu’on doit et peut revitaliser la démocratie en partant du travail ». Cela suppose donc de s’expliquer sur ce qui est entendu ici par « travail », ce mot du quotidien dont l’heureuse polysémie est en même temps un piège pour la pensée, car elle risque de s’y engluer si elle ne veille pas en permanence à ne pas glisser dans son usage, sans s’en rendre compte, d’une signification à une autre.
Les auteurs en sont conscients. Le premier chapitre est en effet consacré à cette question puisqu’il s’intitule « Le travail réel, ça veut dire quoi ». Ils prennent toutefois la décision de ne pas laisser seule la notion de travail, mais de la qualifier. Cette qualification ne s’oppose pas ici au fictif, mais au prescrit. Travail prescrit et travail réel forment un couple indissociable mis en lumière par l’ergonomie. C’est un écart, une tension entre ce qui est à faire et ses conditions de réalisation. Mais cette qualification mise en avant d’entrée de jeu évite aux auteurs de s’interroger sur le « travail ». Elle les projette en effet immédiatement dans une problématique particulière. On comprend pourquoi car ils précisent que leur « hypothèse politique repose sur la considération du travail réel (…) C’est à partir du travail réel que peut se déployer l’émancipation et la démocratie ».
Mais quelle est donc la conception du « travail » sous-jacente au « travail réel » ? Elle n’est pas explicite dans le texte, mais facile à identifier à travers les contextes de son utilisation. Le travail ici n’est envisagé que comme rapport social, ce qui est cohérent avec l’objectif politique des auteurs. Sa dimension anthropologiquement première de rapport des hommes à la nature est quasiment absente. Cela se manifeste par exemple dans les limites données aux « sciences du travail ». Ne sont en effet citées que des sciences humaines : ergonomie, psychologie, sociologie, ergologie. Sont absents toutes les sciences du travail qui éclairent le vivant et qui, seules, ont les moyens scientifiques de nous alerter sur les conséquences du travail planétaire : l’agronomie, l’océanographie, la géologie, la biologie, la climatologie… En outre, et c’est un point majeur dans une perspective de sortie du techno-productivisme destructeur du vivant, ce sont ces sciences – auxquelles il faut alors ajouter l’écologie industrielle – qui fournissent les prescriptions de nature à préserver notre planète de nos excès. Ces sciences de l’ingénieur mettent déjà au point les dispositifs du futur. L’agriculture biologique par exemple dispose de techniques et de méthodes scientifiques assurées. Sa marginalité a des causes économiques et politiques, pas scientifique.
Les préoccupations écologiques ne sont certes pas absentes du Manifeste. C’est même une des cinq raisons présentées dans le chapitre 2 pour laquelle la démocratisation du travail apparait aux rédacteurs comme un objectif légitime et nécessaire : « Démocratiser le travail s’impose aussi pour prévenir, atténuer et réparer les catastrophes et dégradations écologiques. Si l’ignorance est souvent la première excuse des grands industriels pour justifier la destruction de l’environnement, les recherches révèlent bien souvent que ces entreprises étaient au courant des pollutions inhérentes à leurs activités et que les alertes n’ont pas été prises en compte ».
On peut effectivement penser que démocratiser le travail empêcherait, grâce à la libération de l’expression des travailleurs et leur participation aux décisions, que des situations dangereuses mettent en péril l’environnement de l’entreprise. Ce ne pourrait être toutefois qu’une protection a posteriori. Quelle remise en cause a priori, sur la base du travail réel, serait il possible, par exemple du nucléaire ?
Oblitérer la dimension anthropologique du travail, c’est se priver d’une voie d’accès majeure aux problèmes écologiques que l’innovation technique et productiviste ne cesse de faire naitre sous nos pieds. C’est la raison pour laquelle j’ai intitulé mon ouvrage Manuel d’« écologie du travail ». L’écologie du travail, ce n’est pas seulement bien traiter les hommes dans leurs activités productives, c’est aussi bien traiter la nature pour que nous puissions continuer de vivre en complicité avec elle, comme part d’elle. Ma conviction épistémologique est que cela suppose de toujours considérer le travail dans son caractère bifide.
Pourquoi seulement partir du travail « réel » ?
Le Manifeste commence par se faire l’écho d’« une même plainte » : perte du « sens du travail » ; des « organisations actuelles (…) qui l’intensifient et le déshumanisent au nom de la concurrence mondiale ou de la réduction des déficits » ; des « algorithmes (…) qui ont pu simplifier certaines tâches, mais contribuent souvent à réduire le travail à des objectifs chiffrés et permettent d’introduire de nouvelles formes de contrôle des salariés ».
Le travail dont il s’agit ici est entendu comme un singulatif [2]. C’est le travail à hauteur d’homme, tel qu’il est vécu par celui qui l’exerce. Toutefois, celui qui est dénoncé, qui est la cause de cette plainte, n’est pas un singulatif, mais un collectif : c’est le « travail capitaliste » dont l’échelle est aujourd’hui mondiale. C’est un exemple du glissement de sens du mot travail que j’évoquais précédemment, qui permet de désigner d’un même mot deux niveaux de réalité différents.
Partir du travail réel, c’est se placer du côté de ceux qui subissent, du côté du travail subordonné, celui qui a affaire avec des prescriptions qui ne prennent pas en compte, ou mal, les conditions réelles de sa réalisation. C’est un engagement qui honore ses participants. Mais on peut se placer du côté des travailleurs, sans pour autant limiter ses angles d’approche et ses méthodes d’investigation. Pour moi, c’est un peu comme si un ouvrier dans son atelier disposait de multiples outils adaptés à la résolution de problèmes complexes et variés, et décidait de ne toujours utiliser que le tournevis…
Lors de la présentation publique du Manifeste fin janvier, plusieurs intervenants ou participants sont intervenus sur ce même thème, en se demandant si on peut imaginer un futur désirable sur la base de la seule entrée du travail réel et de la problématique de l’écart du prescrit et du réel, que Dominique Méda qualifia de « modèle de la panne ».
Un « travail non professionnel » pensé sur le modèle du travail capitaliste
Les sciences humaines du travail sont pour la plupart nées en Occident au XIX° siècle, dans un contexte marqué par l’industrialisation et ses effets pathogènes sur les travailleurs. Leurs analyses ont d’abord essentiellement porté sur des entreprises industrielles, puis se sont ouvertes aux entreprises de service, aux organisations publiques ou associatives. Aujourd’hui, elles cherchent à prendre en compte d’autres occurrences du travail, notamment le travail domestique.
Le Manifeste à son sujet parle de « travail domestique ou reproductif ». Est ainsi désigné « l’ensemble des activités invisibilisées mais indispensables à la survie et au bien-être des individus et des sociétés : préparer les repas, nettoyer, prendre soin des enfants, des personnes âgées ou malades, organiser la logistique quotidienne… Ce travail, en grande majorité assuré par les femmes, constitue la base sur laquelle repose la production économique et sociale ».
Le travail domestique est par essence un travail acapitaliste. Il est donc intéressant et instructif de l’examiner car il conduit à repenser, sous l’angle du partage, les notions de travail et de rémunération. C’est un exercice auquel je me suis essayé dans un article paru en 2014 (consultable en cliquant sur son titre « Le travail domestique, intime et clandestin »). Mais à la lecture du Manifeste j’ai eu l’impression qu’il n’était pas considéré pour lui-même, mais avec des concepts venus d’ailleurs. J’en relèverai deux indices.
J’ai été d’abord surpris par cette expression de « travail reproductif » car si travail domestique et reproductif se recoupent en partie, ce n’est pas la même chose. Les connotations non plus ne sont pas les mêmes. J’imagine que cette expression fait écho au concept marxiste de reproduction de la force de travail. Or, si le travail domestique vise bien cette reproduction, il le déborde largement car il s’insère dans une vie familiale ou amicale beaucoup plus large.
Mais c’est la proposition faite à son égard qui m’a fait penser que le travail reproductif était conçu comme une extension au domicile du travail « professionnel ». Il est en effet proposé de « politiser le travail reproductif » en accordant « au travail domestique des droits similaires au droit du travail salarié » (droit à l’arrêt de travail en cas de maladie, droit à la retraite) ». Le travail domestique n’est qu’exceptionnellement un travail marchand. Accorder des droits de salarié aux travailleurs domestiques, c’est donc les faire prendre en charge par l’impôt ou des cotisations, dans une assimilation identitaire qui me semble réductrice.
Nous baignons depuis 300 ans dans une civilisation technico-productiviste qui a formaté le travail tel qu’on le connait aujourd’hui. C’est un travail qui a mauvaise réputation, et qui génère notamment, comme le rappelle le Manifeste dans son introduction, « deux manières opposées de (le) voir » : le refuser ou l’émanciper. Le risque toutefois dans les deux cas, c’est de n’avoir qu’une approche réactive qui finalement ne se positionne qu’en référence à ce qui est rejeté. C’est la raison pour laquelle je suis convaincu qu’il faut se libérer de cette entrave du travail connu actuel pour pouvoir penser le travail futur. Pour s’y exercer, il est un bain de jouvence : enquêter sur le travail dans sa longue histoire (il est né en même temps que l’espèce humaine, même si le mot pour le dire est apparu récemment) et sur les formes qu’il a pu prendre dans différentes cultures ou civilisations. On peut y avoir accès, en acceptant leurs incomplétudes, par l’histoire et l’ethnologie notamment. Le travail domestique fait partie de ces formes étrangères au travail capitaliste – même s’il en subit les effets –, d’où l’intérêt de le regarder dans sa logique propre. Il est en effet le seul qui ait cette caractéristique et soit toujours universellement pratiqué, donc parfaitement observable.
Démocratiser le travail
Ces remarques épistémologiques n’enlèvent évidemment rien à l’intérêt et à la valeur de l’objectif politique qui rassemble ce collectif. Leur Manifeste fournit dans son deuxième chapitre (« Pourquoi démocratiser le travail »), outre celui de l’écologie dont j’ai déjà parlé, toute une série d’arguments qui viennent l’étayer :
- Celui de la dignité humaine : « les personnes au travail ne sont ni des « ressources » ni du « capital humain », mais des membres de « la famille humaine » pour reprendre les termes de la Déclaration Universelle des Droits Humains (…) Partant de ce principe, rien ne justifie que les personnes soient de droit ou de fait, exclues de la prise de décision sur une sphère cruciale de leur vie : leur travail et son organisation ».
- Celui de la logique démocratique : « Comment justifier que le principe démocratique soit réservé au seul champ de la cité ? Comment justifier que des citoyen·nes supposé·es libres et égales en droit dans la sphère politique, demeurent subordonné·es dans la sphère économique ? »
- Celui de la santé publique : « L’insoutenabilité organisée du travail engendre un véritable problème de santé publique. Ses principales causes sont bien identifiées par (les études de la Dares [3]) : l’intensité du travail, le manque d’autonomie et l’absence de participation des salarié.es aux décisions. On sait en effet que la possibilité de s’exprimer et de peser sur les choix d’organisation du travail, même de façon limitée, a des répercussions positives sur la santé ».
- Celui de la politique : « Au-delà de la sphère privée, le mal-être au travail impacte aussi les comportements civiques (…) Il est établi que la participation politique décline à mesure que le travail perd en autonomie et en intérêt. Ou que l’absence d’autonomie au travail favorise fortement l’abstention : à métier et qualification identiques, les personnes soumises à un travail répétitif, sans marge de manœuvre, sans possibilité de peser sur les décisions qui les concernent, tendent à s’abstenir beaucoup plus que les autres. Il ne s’agit pas seulement d’un effet de la position sociale, mais aussi et surtout du mode d’organisation du travail ».
Dans le champ politique, la démocratie est loin d’être un système parfait. Les peuples peuvent démocratiquement élire des dirigeants qui excitent les divisions et les violences, plus qu’ils ne rassemblent leur peuple et les nations. Les Etats-Unis en sont une preuve vivante, et loin d’être la seule. Le meilleur des systèmes serait celui qui permettrait d’assurer la permanence de la paix intérieure et extérieure. Malheureusement, il n’existe pas.
Si tous les régimes sont imparfaits, la démocratie, en légalisant des contre-pouvoirs, a l’avantage sur les autres de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La question toutefois se pose de savoir, dans les périodes très troublées qui s’annoncent, comment encore les renforcer. Sur ce plan, le Manifeste fournit une référence qui milite fortement pour la démocratisation du travail. En effet, dans une étude de 2024 [4], Thomas Coutrot montre que les comportements électoraux sont influencés par les conditions de vie au travail, les plus pénibles (absence d’autonomie, horaires atypiques, pénibilité physique) conduisant plus fréquemment à l’abstention ou au vote d’extrême droite.
Des propositions sociales à expérimenter
La conception de propositions en réponse à un diagnostic est un exercice qui reste difficile : jusqu’où aller pour être compris et suivi, tout en restant à la hauteur des problèmes à résoudre ? Les propositions sont en effet toujours sous la menace d’être considérées comme trop tièdes et inefficaces ou trop brûlantes et insoutenables. Ce n’est pas dans ce registre, du trop ou du trop peu, que je souhaite les évoquer.
La proposition centrale avancée par le Manifeste est de déployer des « enquêtes actions » qui dépasserait le cadre limité des enquêtes institutionnelles prévues par le Code du travail pour s’inscrire dans la permanence. « Pour construire une stratégie de démocratisation du travail, l’approche qui nous semble faire référence est celle de l’enquête ouvrière, ou enquête-action sur le travail réel, qui vise à articuler production de connaissance et mobilisation ». Ces enquêtes seraient conduites par les syndicalistes (chapitre 3) et élargies aux acteurs du territoire (chapitre 4) car« l’enquête sur le travail au sein d’une organisation fait souvent ressortir l’enjeu des rapports avec les activités en amont et en aval, et avec le territoire ». Ainsi étendue, elle permettrait d’intégrer des enjeux écologiques.
Le Manifeste propose également d’instituer des « délégués du travail réel » : « Pour améliorer les politiques de prévention des atteintes à la santé au travail, et renforcer le pouvoir d’agir démocratique des travailleur·es sur le travail, nous proposons l’élection de « représentants du travail réel » (…) Cette nouvelle institution permettra d’organiser la prise de parole des salarié·es sur leur travail réel, la remontée d’informations et de propositions d’amélioration sur son organisation au plus près du terrain. Les représentant·es du travail réel siègeront, avec les représentants de la direction, dans un CHSCT rénové qui (…) aura des droits élargis, incluant l’analyse des impacts de l’activité de l’entreprise sur l’environnement, et un droit de veto suspensif sur les décisions managériales menaçant la santé humaine ou environnementale » (chapitre 5).
Ces propositions sont en cohérence avec l’affirmation que l’émancipation des travailleurs passe par le privilège accordé au travail réel. Mais la compétence d’enquête serait une compétence nouvelle pour nombre de travailleurs et de syndicalistes. Sa maîtrise n’a rien d’évident. Les propositions sociales les mieux intentionnées peuvent se fracasser sur le réel. Il y a en effet le même écart entre le prescrit et le réel dans le travail, qu’entre une proposition sociale et sa mise en œuvre. C’est pourquoi il me semble qu’une telle innovation suppose des accompagnements et des expérimentations. L’engager immédiatement à grande échelle serait lui faire prendre le même chemin que la loi Auroux qui a instauré le droit d’expression des salariés sur les conditions et l’organisation du travail. Elle existe toujours dans le Code du travail tout en étant bien peu utilisée dans les organisations.
Reste évidemment à savoir quelles forces syndicales et politiques seraient prêtes à s’engager dans cette voie pour la rendre opérationnelle ? C’est l’enjeu maintenant auquel se trouve confronté les acteurs du Manifeste.
[1] Les Ateliers Travail et Démocratie regroupent des syndicalistes, des chercheurs, des intervenants en santé au travail, en formation, en organisation et des citoyens, qui souhaitent porter dans le débat public l’idée que le travail est une grande question politique et soutenir toutes initiatives de démocratisation du travail.
[2] Pour la distinction singulatif / collectif du travail, voir le Manuel d’écologie du travail, page 10
[3] La Dares (Direction de l’Animation, de la Recherche, des Etudes et des Statistiques) est la direction du Ministère du Travail qui produit des analyses, des études et des statistiques sur les thèmes du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
[4] Thomas Coutrot. « Le bras long du travail. Conditions de travail et comportements électoraux ». Documents de travail Ires, n° 01, 2024. Thomas Coutrot a participé à l’élaboration du Manifeste.