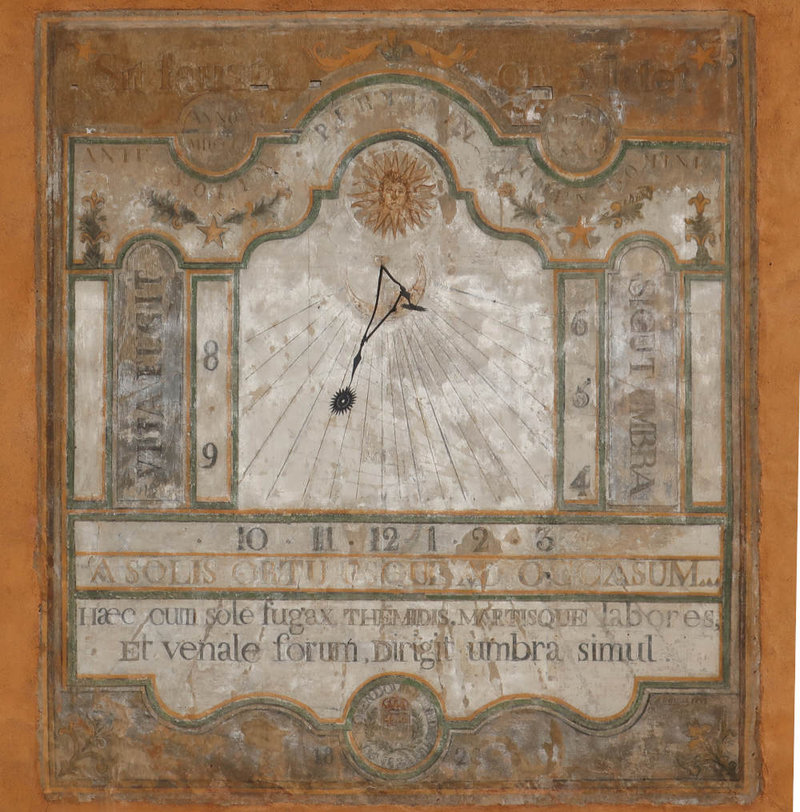Il arrive parfois que ce qui s’impose à nous, ce qui s’oppose à notre volonté ou notre désir, nous fasse plus grandir que ce que nous aurions voulu par nous même ou du moins accepté. C’est une expérience que j’ai pu faire quelques fois dans ma vie. Je me suis alors retrouvé sur des chemins que je n’aurais jamais empruntés sinon, et qui débouchaient sur des prairies qu’en fin de compte je trouvais plus verte. En sera t‘il de même avec l’intrusion dans nos vies du Covid-19 et de ce qu’il a induit comme réponse mondiale ?
Une civilisation est comme un train lancé à grande vitesse. Pour lui donner une nouvelle direction, il faut d’abord le ralentir puis proportionné la courbure de son virage à sa vitesse résiduelle afin de ne pas le faire dérailler. La pandémie a brutalement freiné la course de la nôtre, mais dans une grande impréparation qui va générer en retour de multiples dégâts sociaux et économiques. C’est un coup de semonce toutefois qui peut être salutaire si au lieu de relancer la machine à l’identique pour absorber ou compenser les pertes, on profite de ce ralentissement pour lui faire accomplir les infléchissements nécessaires qui l’orientent vers un futur plus désirable que celui que les scientifiques nous annoncent.
Je concluais l’article précédent de ma chronique Covid-19 (voir Vivre dans un monde dénaturé par le démiurge humain : le Covid-19, nouvelle étape d’une prise de conscience collective) par cette question : « dans ce monde dénaturé par le démiurge humain, que devons-nous faire et comment ? ». J’avais également précisé qu’à cette question nous allions « devoir y répondre, chacun d’entre nous et collectivement ». Aussi, il me semble logique de me lancer dans l’exercice, même si le coronavirus circule toujours très activement sur la planète et qu’il n’a pas fini de provoquer des dommages sanitaires, sociaux et économiques. En revanche, les causes profondes des perturbations écologiques auxquelles nous sommes confrontées agissent depuis longtemps. Nous avons suffisamment d’alertes scientifiques sur leurs causes et sommes suffisamment affectés dans notre vie quotidienne par leurs conséquences – la pandémie du Covid-19 n’étant que la plus récente, mais aussi la plus massive et universelle – pour en tirer des enseignements et réfléchir aux changements et adaptations nécessaires pour moins subir l’arrivée d’un monde épouvantail. Ils le sont déjà d’ailleurs, mais à voix basse, dans les consciences peut-être plus que dans les faits.
Penser globalement, agir localement
Face à plus de 200 ans d’action de notre civilisation technico productiviste sur la planète, à son règne aujourd’hui universel, on peut légitimement se sentir bien petit, impuissant. Mais cette petitesse n’est pas un défaut, c’est un fait et c’est en l’acceptant que l’on peut prendre les meilleures décisions. Nous sommes impliqués dans le monde de diverses manières, dans des réseaux concentriques qui commencent au plus près de nous et dans lesquels notre puissance d’action décroit au fur et mesure que leurs tailles s’accroissent.
Si notre action n’est pour la plupart d’entre nous que locale, c’est en l’inscrivant dans une pensée globale qu’elle se hissera à la hauteur des enjeux de l’époque. Cela ouvre à ceux qui le souhaitent deux voies d’engagement, l’une qui vise à arrêter l’emballement en agissant sur ses causes structurelles, l’autre à se préparer à vivre dans un monde différent que personne n’a voulu, pas même ceux qui s’accrochent au statut quo. La première relève de l’intervention citoyenne et politique, la seconde de choix de vie personnels et communautaires.
Je n’ai pas ici la prétention de livrer un quelconque programme, ni une utopie. Je souhaite seulement proposer les quelques réflexions que m’inspire notre situation collective.
Arrêter l’emballement
C’est le productivisme qui est le levier de cet emballement, mais il doit sa redoutable efficacité à une science et des techniques qui se spécialisent à outrance et privilégient les causalités simples qui s’enchainent sagement. Réduisant ainsi souvent le monde et l’homme lui-même à quelques dimensions mesurables, elles se trouvent à la peine dès qu’il s’agit de penser la complexité des interactions et rétroactions entre les phénomènes. C’est ce à quoi pourtant nous sommes confrontés avec le changement climatique, la réduction de la biodiversité ou même le développement des zoonoses [1]. Il me semble donc nécessaire de développer une réforme de la pensée qui fasse toute sa place à la complexité, à la fois dans le champ du savoir et dans celui de l’éducation.
Dans les sciences, cela pourrait passer par une sorte d’obligation ou de privilège accordé à la pluridisciplinarité, en organisant systématiquement, à partir des problèmes à résoudre ou des réponses à inventer, le mariage des disciplines pertinentes existant au sein des sciences de la nature et des études humaines. Sur ces problèmes complexes, aucune légitimité scientifique ne devrait être accordée à des approches unijambistes.
Dans le champ de l’éducation, il faudrait intégrer tôt dans les parcours l’étude en petits groupes de phénomènes complexes. Il est des sujets, voire des disciplines, particulièrement porteurs dans ce domaine : la vie des sols, la relation ethnologique des hommes à la nature, les phénomènes climatiques, la philosophie… Ce ne sont certes pas des actions efficaces à court terme, mais fort utiles à moyen et long terme, en nous permettant de mieux comprendre les phénomènes planétaires auxquels nous devrons faire face.
Dans le champ politique, c’est un autre mariage qui peut être porteur d’avenir, celui du social et de l’écologie, en ce que le premier est la condition d’acceptabilité du 2nd. En effet, les ruptures avec nos modes de production et de vie qu’exigera l’arrêt de l’emballement supposeront un accord social qui ne saurait s’envisager sans rupture avec les inégalités sociales. Ramener dans un rapport de 1 à 4 les écarts de revenu et de patrimoine au sein des communautés de vie, ré enrichir en parallèle les Etats sociaux, orienter le développement technique dans le sens du progrès écologique et de l’amélioration des conditions de travail, rendre publique ou collective la propriété des communs notamment la terre et l’eau, favoriser l’autonomie productive locale et particulièrement celle des pays pauvres sont des exemples d’objectifs qui peuvent permettre de rompre, aussi vite que possible socialement, avec le productivisme. C’est évidemment la tâche la plus délicate car elle suppose de naviguer entre deux excès, celui du trop vite et celui du trop lentement. En la matière, l’histoire des hommes montre à l’envie que radicalité et démocratie n’ont pas souvent fait bon ménage. Quand la radicalité l’emportait, elle s’accompagnait généralement de terreurs, violences et massacres et la démocratie disparaissait ; à l’inverse quand la vie démocratique était respectée, c’était la radicalité qui était renvoyée sine die.
Compte tenu de l’ampleur des changements économiques et sociaux que cela suppose, et des impasses, violences ou massacres auxquels ont aboutis les formules révolutionnaires du XX° siècle pour en instaurer, je suis convaincu que seule la voie démocratique est de nature à prendre en compte les multiples réactions sociales qu’ils génèreront nécessairement, en maintenant le cap de la paix civile et internationale. En France, ce mariage, sur le fond, est en cours à gauche. Il restera à le prouver dans les faits, dans un projet commun et lors des échéances électorales.
Pour ne citer qu’eux, la diminution des ressources naturelles et leurs pollutions, le changement climatique, le développement productif de la Chine, l’actuelle vague pandémique ont des impacts internationaux et génèrent des bouleversements géopolitiques majeurs qui sont loin d’être achevés. Ils signent la fin d’une régulation internationale instaurée à l’issue de la deuxième guerre mondiale qui avait su en éviter de nouvelles. Les Etats Unis vont perdre leur hégémonie et ce sont des puissances au gouvernement totalitaire qui risquent de se la partager. Dans ce monde devenu dangereux, l’Union européenne m’apparait comme un îlot de sagesse politique. Elle le doit probablement à son histoire, mais aussi à sa nature même qui consiste à accepter par principe la régulation en son sein par des compromis. Toute tentative interne de remettre en question ce principe ou de s’écarter de son périmètre comme l’a fait le Royaume Uni ne pourrait qu’ajouter de la confusion et des risques aux turbulences internationales déjà en cours. Il ne faut en effet jamais oublier que les guerres dévastatrices nous sont toujours vendues et imposées par les puissants comme une « solution » au désordre du monde…
Se préparer à vivre dans un monde différent
Essayer de penser globalement a quelque chose d’effrayant car cela met au jour les menaces qui pèsent sur nous tout en creusant parallèlement un sentiment d’impuissance face à elles. Mais c’est la vie elle-même dont nous ne sommes pas maîtres. La vieille distinction stoïcienne prend ici toute sa valeur : il y a ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. Que faire alors à notre petite échelle ?
A chaque génération ses défis. Au XX° siècle, on a pu être paysan et se retrouver engagé dans la boucherie de la première guerre mondiale, juif allemand et victime de l’holocauste, baby-boomer et profiter de la société de consommation tout en protestant contre elle… On ne choisit pas les affres ou la sauvagerie de son temps. Mais la perspective aujourd’hui dans laquelle inscrire toute sa vie est pour la première fois d’une grande clarté dès lors que l’on fait confiance aux savoirs et méthodes accumulés dont la science dispose désormais pour déchiffrer le monde. Pour plusieurs générations, il s’agira de vivre, sous un climat plus chaud, sur une terre salie, appauvrie en ressources vivantes et fossiles, à réparer donc…
« La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil » écrivit René Char. Cette blessure est souhaitable et nécessaire ; elle n’est pas une invitation aux tremblements mais la condition d’une action raisonnable et utile car elle permet de prendre la mesure de notre fragilité face aux évènements de toute sorte qui accompagnent et parfois détruisent nos vies ou celles des êtres qui nous sont chers.
A titre individuel comme au sein de son réseau relationnel, il me semble que le meilleur moyen de s’orienter avec lucidité, c’est d’agir comme si nous vivions dans le monde que l’on souhaite voir advenir. En tant que citoyen, cela signifie soutenir et s’engager en faveur des initiatives collectives ou politiques qui luttent contre les inégalités sociales et œuvrent pour la paix et la réconciliation des hommes avec le vivant ; en tant que consommateur, privilégier, à la hauteur de ses moyens, ce qui respecte le mieux la nature ; en tant que producteur, s’orienter dès que possible vers des activités réparatrices ou porteuses d’avenir soutenable : agriculture agroécologique, construction et transport durables et économes, énergies renouvelables, écologie industrielle [2], services dont l’utilité sociale restera évidente y compris dans le monde de demain… Il est aussi un moyen universel d’agir en faveur d’un monde plus respectueux du vivant, c’est de lutter, là où l’on travaille, dans des entreprises polluantes, gaspilleuses, pour des conditions de travail respectueuses de notre humanité, c’est-à-dire refuser à tout le moins que les hommes participent, par l’usure de leur corps et de leur esprit, à l’emballement productiviste.
Les menaces qui assombrissent l’avenir et qui envahissent les médias ont un effet socialement dépressif qui est en lui-même un danger car il pousse à l’abattement ou la désespérance. Je ne connais pas de recette qui permette d’y faire face, si ce n’est de conserver à l’esprit des pensées chasseuses d’ombre. C’est sur deux d’entre elles que je terminerai donc cet article. D’abord, il peut être utile de se rappeler que les hommes ont traversé dans la très longue durée de leur préhistoire, avec des moyens techniques sans commune mesure avec les nôtres, des époques aussi difficiles que celles qui nous sont annoncées. Notre planète ne deviendra pas invivable. La seconde, c’est que face aux épreuves, les réponses les plus efficaces sont celles qui sont collectives et solidaires. Entre les Etats et nous, il y aura toujours la possibilité de faire vivre des communautés amicales et familiales, protectrices et entrepreneuses…
[1] Sur ce dernier point, voir le chapitre « Passivité du coronavirus et activité humaine » dans l’article Vivre dans un monde dénaturé par le démiurge humain : le Covid-19, nouvelle étape d’une prise de conscience collective.
[2] Voir dans Le travail contre nature, chapitre « Que serait une politique écologique du travail ? »